Élodie Vercken, chercheuse INRAE à l'Institut Sophia Agrobiotech, étudie l’expansion des populations introduites, notamment des ravageurs de cultures ou des agents de lutte biologique, en examinant comment elles s’établissent et se propagent dans de nouveaux environnements.

Les coulisses d'une carrière en recherche
Élodie Vercken, chercheuse INRAE à l'Institut Sophia Agrobiotech, étudie l’expansion des populations introduites, notamment des ravageurs de cultures ou des agents de lutte biologique, en examinant comment elles s’établissent et se propagent dans de nouveaux environnements.
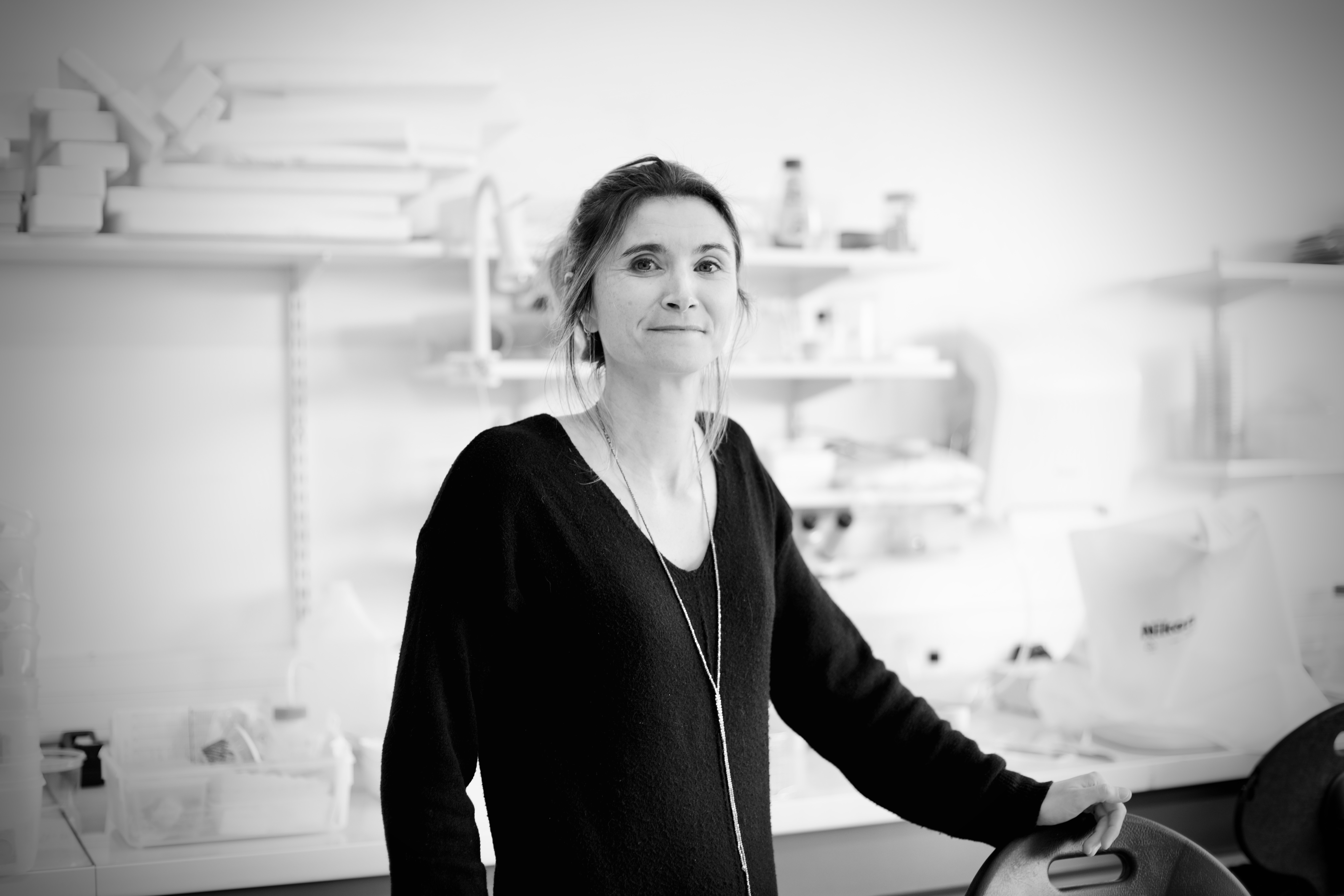
Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?
« Au début de mes études en biologie, nous avions dû faire des projets autonomes sur le thème de la couleur. Certains groupes avaient eu des approches de sciences de l’ingénieur, en cherchant à reproduire des synthèses biochimiques ou des procédés biomécaniques. Avec mon groupe, nous avions mené une expérience d’évolution sur des cyanobactéries. Il n’y avait aucun intérêt appliqué à cette question, mais beaucoup de curiosité, de fun et de fascination. »
Qu'est-ce qui vous a initialement attirée vers votre domaine de recherche ?
« En sciences de la nature, il y a deux grands types de questions : les questions « comment » (par exemple : comment les colonies de fourmis se reconnaissent ?) et les question « pourquoi » (pourquoi les fourmis vivent-elles en colonies ?).
L’écologie évolutive, c’est le domaine qui cherche à répondre aux questions « pourquoi », c’est trop bien de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. »
En quoi consiste votre recherche dans le monde réel ?
« Je n’aime pas trop cette formule de « monde réel », qui a été utilisée pour discréditer le discours scientifique sur les grands enjeux de société. La science, c’est justement le monde réel, celui qui est observable et mesurable. En termes d’applications, je suis impliquée dans un projet visant à développer des méthodes de gestion des populations envahissantes basées sur les caractéristiques des expansions poussées. »
Ses inspirations
« J’ai une admiration particulière pour les travaux qui font le lien entre théorie et pratique, en imaginant des expérimentations simples et élégantes qui permettent de démontrer des résultats théoriques. Les expériences historiques de Gause (sur l’exclusion compétitive), de Huffaker (sur la stabilité de systèmes proie-prédateur), de Hallatscheck (sur les fronts d’expansion) m’ont donné envie de travailler à l’interface entre théorie et expérimentation. »
La médiation scientifique selon Élodie Vercken
Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?
« Je concentre mes activités de médiation scientifique sur la question des crises écologiques et climatiques. J’interviens régulièrement sur le sujet de l’effondrement de la biodiversité. Ces sujets sont essentiels à partager avec le public, à la fois pour augmenter le niveau de conscience des citoyennes et des citoyens et pour améliorer la confiance dans la science et les scientifiques en abordant ces questions de manière transparente et centrée sur les faits. »
Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?
« Rendre accessible la connaissance au plus grand nombre fait partie de nos missions. Dans le cas particulier des grands enjeux écologiques se rajoute une responsabilité des scientifiques d’alerter le public des menaces imminentes, de déconstruire les discours de greenwashing portés par un petit nombre d’acteurs très médiatisés et de mobiliser les citoyennes et les citoyens vers l’action. »
Partager vos recherches avec les scolaires est-il un moyen efficace pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences ,et pourquoi pas, de s'orienter vers les sciences ?
« Il me semble que la recrudescence des complotismes démontre la nécessité d’une éducation scientifique populaire et citoyenne. La médiation scientifique a évidemment un rôle à jouer, et nécessite selon moi de repenser et retravailler les rapports science-société pour améliorer l’accessibilité et la proximité avec le public. Il est essentiel de multiplier les occasions de rencontre et les formats d’interaction, de manière à désacraliser et populariser le rapport au savoir, empreint en France d’une forte culture de l’élitisme. »
Auriez-vous une anecdote à nous raconter en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?
« Le discours scientifique est souvent perçu comme inaccessible car trop théorique (savoir « froid ») et déconnecté de l’expérience personnelle (savoir « chaud »).

Pour aborder l’effondrement de la biodiversité, je mets en avant l’expérience sensorielle, avec l’écoute de « paysages sonores » (enregistrements faits dans différents écosystèmes), et l’explication du syndrome de « référence changeante » (une sorte d’amnésie collective des états passés de notre environnement). Cette approche permet de faire ressentir de manière intime la perte de biodiversité autour de nous, et de donner une dimension émotionnelle et personnelle à un phénomène global. »
Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec les chercheuses et les chercheurs pour prendre certaines décisions ?
« Les décisions politiques devraient être éclairées par les sciences, aussi bien les sciences de la nature que les sciences sociales. L’idée n’est pas d’avoir une scientocratie. Ce n’est pas aux scientifiques de choisir les orientations politiques, mais aussi bien les décideurs que les citoyens devraient avoir accès aux données scientifiques sur les implications des différents choix politiques, afin de pouvoir exercer leur pouvoir démocratique de manière éclairée et consciente. »
L'objet d'Élodie Vercken

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à cette chercheuse de choisir un objet emblématique de ses études.
Le résultat ? Un carnet de post-it !
« J'ai choisi un carnet de post-it colorés qui constituent la base de mes écosystèmes expérimentaux (c’est sur la colle des post-it qu’on dispose les œufs de papillon que nos micro-guêpes de laboratoires vont parasiter). »
Découvrez le projet PUSHTOIDELA !
