Publié le 22 août 2025 – Mis à jour le 16 septembre 2025
William Guerin, chercheur au sein de l'Institut de Physique de Nice (INPHYNI), développe des techniques avancées pour l'observation astronomique.
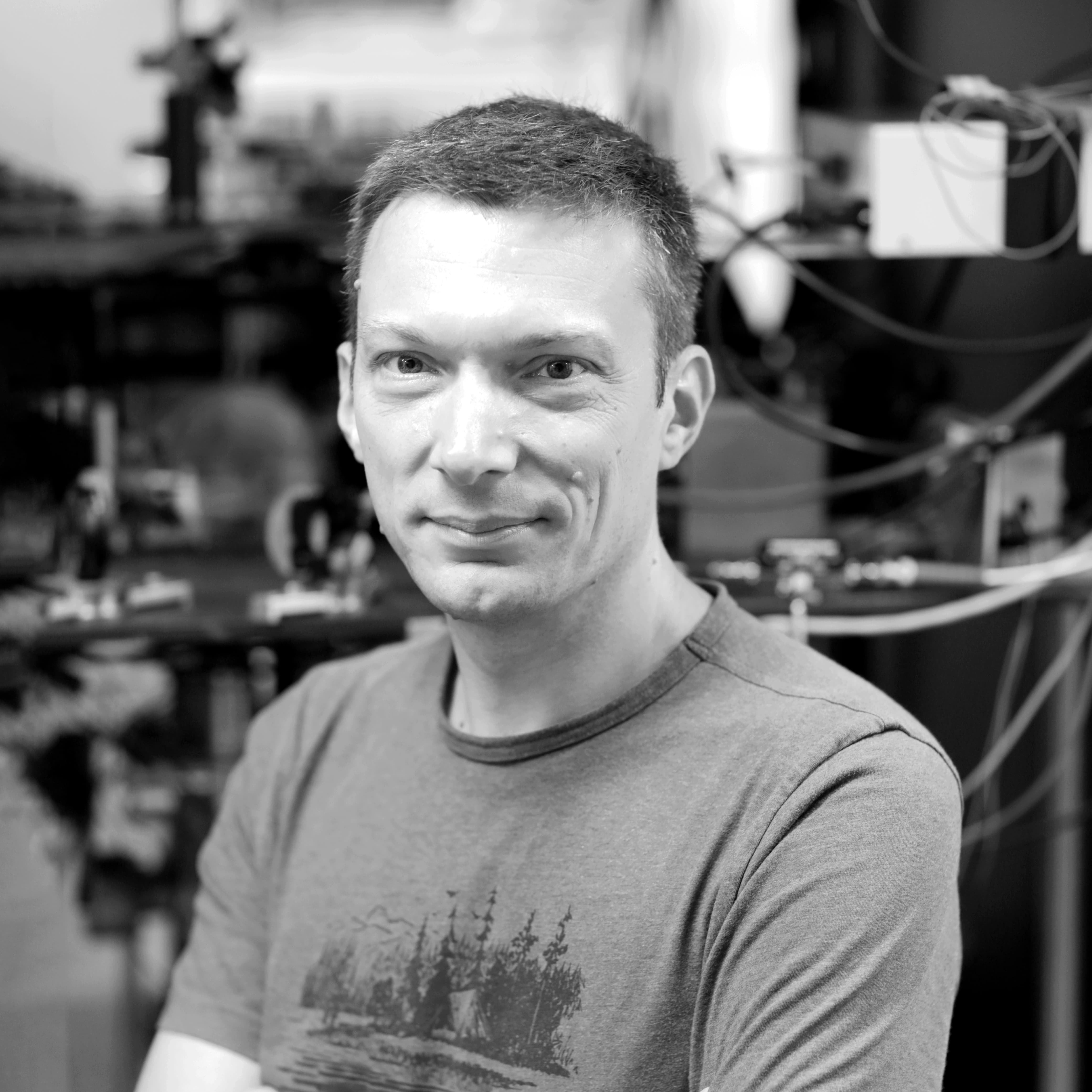
LES COULISSES D'UNE CARRIÈRE EN RECHERCHE
William Guerin, chercheur au sein de l'Institut de Physique de Nice (INPHYNI), développe des techniques avancées pour l'observation astronomique. 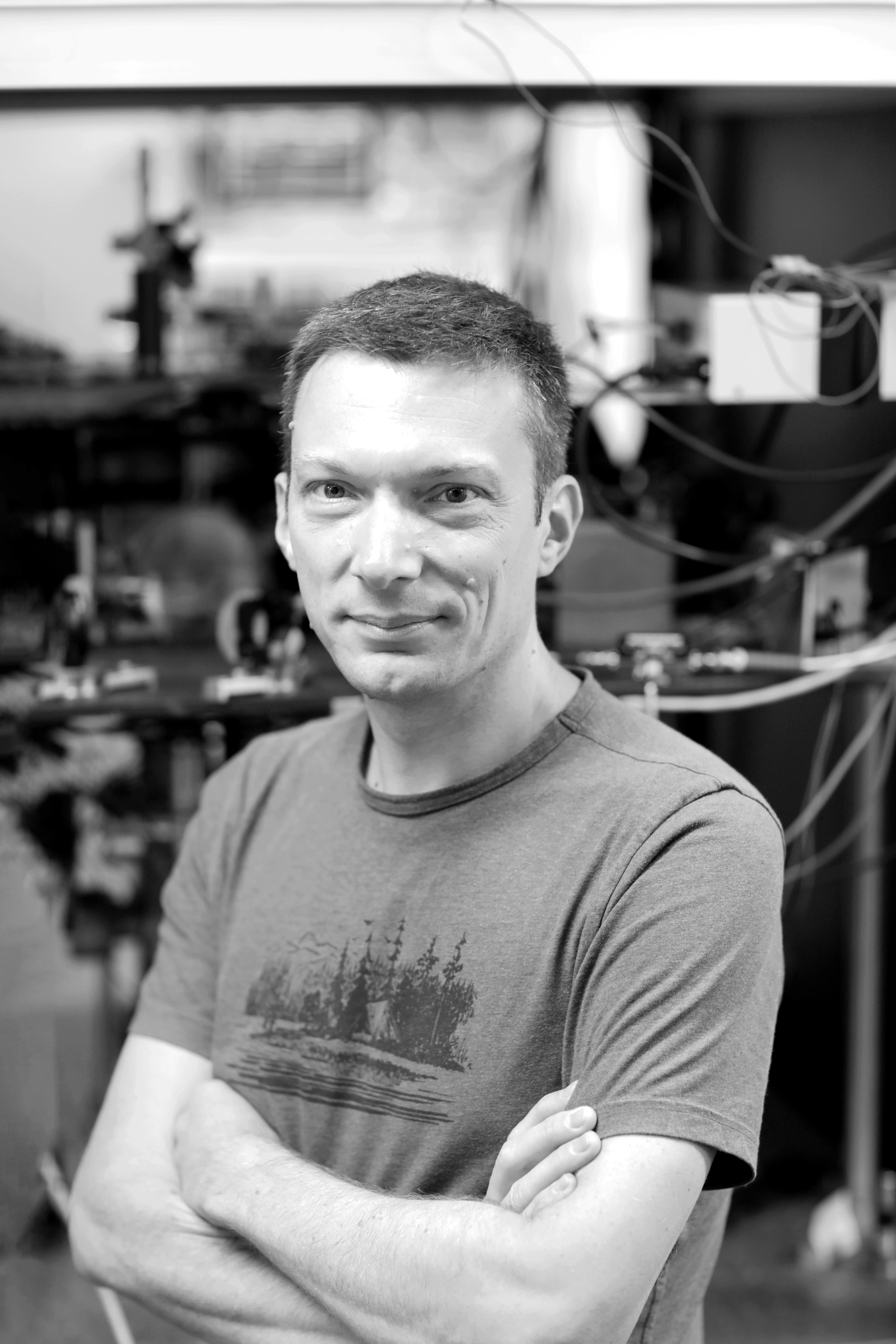
Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers votre domaine de recherche ?
"J’ai toujours été curieux du fonctionnement de la nature et donc, naturellement intéressé par les sciences, toutes les sciences en général. Je crois que mon coup de cœur pour la physique date de vers 15-16 ans et de mes lectures sur la relativité et la physique quantique, dans des magazines de vulgarisation (« Sciences & Vie » à l’époque). J’ai acquis à cette époque une fascination, puis une attirance, pour la recherche en physique fondamentale. Après, les concours de circonstances ont fait le reste…"
Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?
"J’ai toujours été attiré par ce métier, qui me paraissait inaccessible lorsque le je lisais les interviews de chercheurs dans les magazines de vulgarisation. Et puis de fil en aiguille je me suis retrouvé en fin de thèse, et c’est là que j’ai dû faire un choix entre me lancer dans l’aventure des post-doc et des concours de recrutement, ou bien aller dans l’industrie. Décision qui n’a rien eu d’évident pour moi."
"J’ai toujours été curieux du fonctionnement de la nature et donc, naturellement intéressé par les sciences, toutes les sciences en général. Je crois que mon coup de cœur pour la physique date de vers 15-16 ans et de mes lectures sur la relativité et la physique quantique, dans des magazines de vulgarisation (« Sciences & Vie » à l’époque). J’ai acquis à cette époque une fascination, puis une attirance, pour la recherche en physique fondamentale. Après, les concours de circonstances ont fait le reste…"
Y a-t-il eu un moment particulier dans votre vie où vous avez su que vous vouliez devenir chercheuse ?
"J’ai toujours été attiré par ce métier, qui me paraissait inaccessible lorsque le je lisais les interviews de chercheurs dans les magazines de vulgarisation. Et puis de fil en aiguille je me suis retrouvé en fin de thèse, et c’est là que j’ai dû faire un choix entre me lancer dans l’aventure des post-doc et des concours de recrutement, ou bien aller dans l’industrie. Décision qui n’a rien eu d’évident pour moi."
LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE SELON WILLIAM GUERIN
Que vous apporte de parler de vos recherches au grand public ?
"Je trouve que c’est à la fois très important et très gratifiant. Mais je dois avouer que je le fais assez peu, par manque de temps. Certains collègues sont beaucoup plus actifs que moi dans ce domaine et je voudrais leur rendre hommage."
Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?
"Je pense que la plupart des chercheurs sont convaincus de l’importance de la médiation scientifique. C’est plus le temps qui fait défaut pour s’impliquer. Moi le premier !"
Auriez-vous une anecdote à partager en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?
"Ce n’est pas vraiment une anecdote, mais j’ai participé il y a deux ans à la Nuit des Coupoles Ouvertes organisée par l’Observatoire de la Côte d’Azur sur le plateau de Calern. C’est un évènement qui attire plusieurs milliers de visiteurs, dans un endroit pourtant relativement éloigné des centres urbains. Les gens sont ravis de pouvoir discuter avec des chercheurs. J’ai trouvé ça très gratifiant, mais je retiens surtout que le grand public est intéressé par la science ! Il n’y a pas assez de sciences dans les médias généralistes."
Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec des chercheuses et chercheurs pour prendre certaines décisions ?
"C’est certain ! La proportion de scientifiques dans les cabinets ministériels a beaucoup décliné ces dernières années/décennies. Les politiques eux-mêmes ont quasiment tous des formations non scientifiques (à part quelques médecins). Et même dans les domaines dans lesquels ils ont fait leurs études, ils n’ont jamais été confronté à une démarche de recherche, contrairement à leurs homologues allemands, qui ont presque tous un doctorat.
L’expertise scientifique doit permettre aux politiques de baser leurs décisions sur des constats objectifs, à l’état de l’art des connaissances. Et l’esprit de rigueur scientifique devrait permettre de prendre des décisions plus rationnelles et moins idéologiques. Enfin, une expérience de recherche apprend l’humilité.
"Je trouve que c’est à la fois très important et très gratifiant. Mais je dois avouer que je le fais assez peu, par manque de temps. Certains collègues sont beaucoup plus actifs que moi dans ce domaine et je voudrais leur rendre hommage."
Que diriez-vous à un collègue pour le convaincre de se lancer dans la médiation scientifique ?
"Je pense que la plupart des chercheurs sont convaincus de l’importance de la médiation scientifique. C’est plus le temps qui fait défaut pour s’impliquer. Moi le premier !"
Auriez-vous une anecdote à partager en lien avec votre expérience en médiation scientifique ?
"Ce n’est pas vraiment une anecdote, mais j’ai participé il y a deux ans à la Nuit des Coupoles Ouvertes organisée par l’Observatoire de la Côte d’Azur sur le plateau de Calern. C’est un évènement qui attire plusieurs milliers de visiteurs, dans un endroit pourtant relativement éloigné des centres urbains. Les gens sont ravis de pouvoir discuter avec des chercheurs. J’ai trouvé ça très gratifiant, mais je retiens surtout que le grand public est intéressé par la science ! Il n’y a pas assez de sciences dans les médias généralistes."
Pensez-vous que les décideurs politiques pourraient davantage échanger avec des chercheuses et chercheurs pour prendre certaines décisions ?
"C’est certain ! La proportion de scientifiques dans les cabinets ministériels a beaucoup décliné ces dernières années/décennies. Les politiques eux-mêmes ont quasiment tous des formations non scientifiques (à part quelques médecins). Et même dans les domaines dans lesquels ils ont fait leurs études, ils n’ont jamais été confronté à une démarche de recherche, contrairement à leurs homologues allemands, qui ont presque tous un doctorat.
L’expertise scientifique doit permettre aux politiques de baser leurs décisions sur des constats objectifs, à l’état de l’art des connaissances. Et l’esprit de rigueur scientifique devrait permettre de prendre des décisions plus rationnelles et moins idéologiques. Enfin, une expérience de recherche apprend l’humilité.
"

En quoi votre recherche a-t-elle des implications pratiques ou des applications dans le monde réel ?
"Le projet I2C porte sur le développement de nouveaux instruments d’observation en astronomie. Les nouvelles observations rendues possibles relèvent essentiellement de la physique des étoiles : c’est donc de la recherche assez fondamentale. Mais je trouve qu’en astronomie, la recherche fondamentale n’est jamais très éloignée des questionnements philosophiques voire métaphysiques : que l’on songe à la révolution Copernicienne !"
Ses inspirations
"Je pense que ce sont les chercheurs bien plus brillants que moi, et ils sont nombreux, que j’ai la chance de côtoyer."
L'objet de William Guerin

Pour sortir des sentiers battus, nous avons demandé à ce chercheur de choisir un objet emblématique de ses études.
Le résultat ? Une valise !
"Le choix de cette valise pour illustrer notre projet relève plus de la blague qu’autre chose. Néanmoins cette valise dit quand même quelque chose de profond : c’est avec elle que nous avons transporté tout notre matériel pour réaliser des observations au Chili. Cela illustre la simplicité et l’adaptabilité de l’interférométrie d’intensité. Par opposition, l’interférométrie directe repose sur des infrastructures complexes et absolument pas transportables !"
Découvrez le projet I2C
Le résultat ? Une valise !
"Le choix de cette valise pour illustrer notre projet relève plus de la blague qu’autre chose. Néanmoins cette valise dit quand même quelque chose de profond : c’est avec elle que nous avons transporté tout notre matériel pour réaliser des observations au Chili. Cela illustre la simplicité et l’adaptabilité de l’interférométrie d’intensité. Par opposition, l’interférométrie directe repose sur des infrastructures complexes et absolument pas transportables !"
Découvrez le projet I2C
