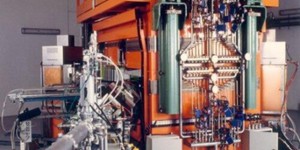L’aversion proclamée de Donald Trump pour les déficits commerciaux l’a rapidement poussé, dès le début de son second mandat, à dénoncer un déficit excessif (bien qu’exagéré) des États-Unis envers l’Union européenne (UE). Le taux historique de 20 % de droits de douane imposé aux importations européennes, annoncé en avril 2025 et suspendu depuis, vise tout d’abord à réduire ce déficit bilatéral. Malgré cette pause dans la politique des droits de douane, il convient d'étudier en détail la composition des causes du déficit entre les États-Unis et l'Union européenne.
Ce déséquilibre commercial entre les États-Unis et l’UE s’est en effet largement et rapidement dégradé ces dernières années, jusqu’à atteindre 169 milliards de dollars en 2023 (données de la base pour l’analyse du commerce international (Baci)), soit environ 0,6 % du PIB des États-Unis cette année-là.
Mais, au-delà de cette dégradation, il est possible de voir des changements structurels à l’œuvre qui sont inquiétants pour les États-Unis et pour leur compétitivité vis-à-vis du partenaire européen.
Aggravation récente du déficit
Le déficit commercial des États-Unis envers l’Union européenne n’est pas récent, et existe dès la création de l’UE au milieu des années 1990. Toutefois, il s’est largement aggravé ces dix dernières années, comme le montre la figure 1 ci-dessous. Cette détérioration s’explique facilement : la demande outre-Atlantique était stimulée par une croissance bien plus forte qu’en Europe.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
En effet, depuis 2008, la croissance cumulée des États-Unis atteint 27 % contre seulement 16 % dans l’UE. Une seconde raison est l’appréciation relative du dollar (inférieur à 0,8 € jusqu’en 2014, autour de 0,9 € depuis), rendant les biens européens moins chers pour le consommateur américain. Réciproquement, cet écart de taux de change limite la compétitivité des biens « Made in USA » sur le marché européen.
Cependant, cette évolution est également structurelle. Cela est visible si l’on regarde la composition des exportations de chacun, comme le reporte la figure 2, ci-dessous.
Les exportations européennes vers les États-Unis ne changent pas beaucoup sur la période, on remarque seulement une augmentation de la part de la section VI de la classification « Harmonized System » correspondant aux industries chimiques (et pharmaceutiques), de 20 % à 30 % du total. Les exportations européennes sont donc surtout concentrées sur les sections VI, XVI (machines et appareils) et XVII (matériel de transport) qui représentent, à elles seules, deux tiers des exportations européennes vers les États-Unis.
Fortes exportations de pétrole
À l’inverse, dans les exportations américaines vers l’UE, la part de l’industrie chimique se maintient (légèrement supérieure à 20 %), mais les autres points forts traditionnels (qui étaient, comme l’Europe, les sections XVI et XVII) diminuent assez sensiblement au profit des exportations de la section V (minéraux) et, tout particulièrement, de pétrole, depuis 2022.
Les exportations états-uniennes deviennent dès lors nettement plus concentrées que les exportations européennes, même si la tendance est notable dès 2020.
Cette concentration des exportations de chaque bloc dans leurs domaines respectifs va de pair avec une diminution du commerce intrabranche, c’est-à-dire de flux croisés (importations et exportations) de biens similaires, comme le montre l’indice de Grubel et Llyod :
Déficit en termes de valeur ajoutée
L’analyse ci-dessus, malgré son intérêt, reste profondément biaisée pour identifier ce qu’il y a d’« états-uniens » qui est consommé en Europe, et inversement. En effet, dans l’économie globalisée actuelle, les biens exportés des États-Unis vers l’UE ne sont pas forcément fabriqués aux États-Unis. À vrai dire, une part non négligeable de la valeur ajoutée de chaque exportation provient de l’étranger, et parfois même du pays « importateur ».
Ainsi une vision plus correcte des déficits bilatéraux consiste à regarder le déficit commercial non plus en valeur brute, mais en valeur ajoutée. C’est toute l’ambition du programme Trade in Value Added (Tiva) de l’OCDE. D’après ces données, qui s’arrêtent en 2020, le solde commercial en valeur ajoutée est encore plus à l’avantage de l’Union européenne à 27 que le solde commercial brut.
Ainsi, le solde commercial en valeur ajoutée diverge de plus en plus du solde commercial brut qui est au centre des discussions. En 2020, le déficit en valeur ajoutée est 1,79 fois supérieur au déficit observé en valeur brute, contre un rapport de 1,06 en 2000 !
Les consommateurs américains consomment donc de plus en plus de la valeur ajoutée créée en Europe – à travers la hausse des importations de l’UE, mais pas seulement. Et si la réciproque est vraie pour les consommateurs européens, jusqu’en 2019, la tendance est nettement moins marquée.
Complexité des biens échangés
Enfin, une dernière dimension à étudier est la qualité des exportations de chaque partenaire dans cette relation bilatérale. En effet, les spécialisations commerciales sont plus ou moins bénéfiques dans le sens qu’elles peuvent favoriser le pays exportateur ou, au contraire, se révéler perdantes pour lui.
Par exemple, un pays dont l’économie s’enferme dans une trop forte spécialisation en biens primaires risque de voir le déclin de l’industrie et à terme de la croissance, comme l’illustre l’exemple du « mal Hollandais » ou les « malédictions des ressources naturelles ».
Ce potentiel bénéfique des paniers de spécialisation a été labellisé « complexité économique ». Il se calcule à la fois pour chaque bien (un bien est-il plus ou moins « complexe » à produire ?), mais aussi au niveau des États (un pays exporte-t-il des biens complexes ou non ?).
Si, au début de la période observée, les scores de complexité des deux partenaires étaient similaires, et ce jusqu’en 2017 (voire supérieurs pour les États-Unis avant 2010), la complexité des biens exportés de l’UE vers les États-Unis augmente tendanciellement depuis 2015, quand elle baisse drastiquement depuis 2017 aux États-Unis. La forte spécialisation des États-Unis dans les combustibles fossiles et l’abandon relatif de la spécialisation dans l’industrie pèse donc sur la complexité des biens échangés.
Et les services ?
Les États-Unis voient donc leur déficit commercial avec l’Union européenne se dégrader fortement depuis dix ans. Cependant, ce déficit apparent est encore moins marqué que le décrochage du commerce en valeur ajoutée entre les deux blocs. Cela va de pair avec une réorientation structurelle des exportations américaines vers une plus grande part de ressources naturelles, qui explique une concentration des exportations, une plus faible part des échanges intrabranches dans le total et un décrochage de la complexité des exportations américaines, qui pourrait à terme profiter à l’Union européenne.
Toutefois, il convient de noter que toutes ces observations ne prennent en compte que le solde du commerce en biens et ignorent la dimension du commerce de services.
On sait déjà que la prise en compte de ce commerce de services réduit des deux tiers le déficit commercial bilatéral des États-Unis avec l’Union européenne, grâce à leurs monopoles dans les nouvelles technologies.
Cependant, cela ne change pas notre conclusion principale, à savoir que ce décrochage dans le solde commercial des biens démontre un changement structurel profond des exportations américaines vers l’UE, qui abandonnent l’industrie de pointe pour se concentrer sur les deux autres extrémités du spectre : les ressources naturelles et les services numériques.![]()
Charlie Joyez, Maitre de Conférence en économie, Chercheur au GREDEG (Université Côte d’Azur, CNRS, INRAE)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
THE CONVERSATION
Université Côte d’Azur, par son service Science et Société, a adhéré depuis janvier 2022 au média d’actualité en ligne « The conversation ». L’objectif est de mettre en valeur les travaux de nos équipes de recherche au service d’une information éclairée et fiable qui participe au débat citoyen.
The Conversation est un média en ligne et une association à but non lucratif. Son modèle de collaboration entre experts et journalistes est unique : partager le savoir, en faisant entendre la voix des chercheuses et chercheurs dans le débat citoyen, éclairer l'actualité par de l'expertise fiable, fondée sur des recherches.
theconversation.com
ABONNEZ-VOUS !
Pour suivre au quotidien les experts de The Conversation, abonnez-vous à la newsletter.
theconversation.com/fr/new