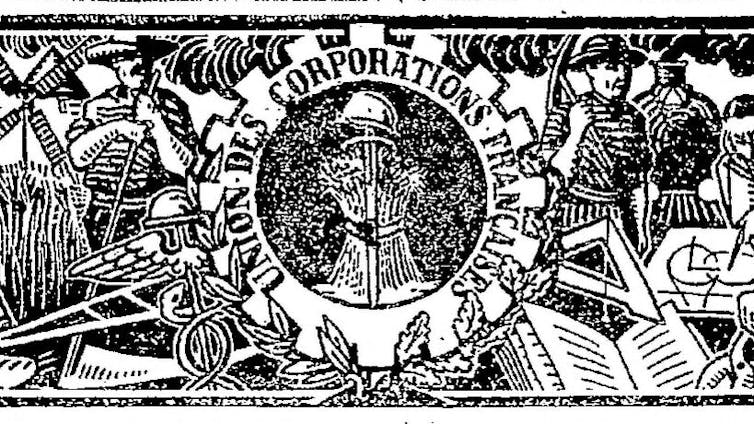
Des années 1960 aux années 1980, les étudiants en économie ont dans leur main le manuel de l’Histoire de la pensée économique, d’Henri Denis (1913-2011). Tour à tour corporatiste, proche de Vichy, progressiste chrétien, communiste, ce dernier termine ses jours en reniant le communisme et en revenant au corporatisme. Un universitaire brillant et une girouette idéologique épousant la doctrine du moment.
Du début des années 1960 aux années 1980, l’histoire de la pensée économique a pour figure centrale le professeur Henri Denis (1913-2011). Il enseigne à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, en étant l’auteur d’un manuel d’Histoire de la pensée économique.
De la première édition de 1966 à nos jours, ce manuel connaît plusieurs éditions successives et est traduit en huit langues. « Le Denis » est entre les mains des étudiants durant toutes ces années. Le cours délivré par Henri Denis forme plusieurs générations d’apprentis en sciences économiques.
Une large partie du manuel et du cours d’Henri Denis est consacrée à l’économie de Karl Marx. Bien que ce professeur d’université se réclame de l’auteur du Capital, il ne fut pas toujours un marxiste, à en juger par sa trajectoire proche de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, il symbolise l’engagement doctrinal d’économistes dans le mouvement corporatiste, selon lequel les représentants des salariés identifient leur intérêt (de corporation) à l’intérêt général.
Alors, peut-on séparer l’homme de connaissance (théoricien) de l’homme individuel (politisé) ?
Disciple d’un vichyste
Lorsque l’on aborde la question du positionnement politique des économistes français lors de la Seconde Guerre mondiale, une figure emblématique surgit, celle de François Perroux, qui adhéra au régime de Vichy. Celle de son disciple et collègue Henri Denis est beaucoup moins connue en ce domaine.
Celui qui allait conquérir une notoriété universitaire en tant qu’historien de la pensée économique a épousé la doctrine corporatiste. Il partage les valeurs politiques de celui qui est l’un des membres de son jury de thèse, thèse soutenue le 7 mars 1938 à la Faculté de droit de Paris, « Les récentes théories monétaires en France. Idée quantitative et conflit des méthodes ».
Pour resituer le contexte, rappelons que l’entre-deux-guerres, avec en particulier le choc de la Grande Dépression (années 1930), est propice pour certains économistes à une réflexion autour d’un ordre économique nouveau, condensant un refus du libéralisme et du communisme. En économie, comme dans le reste des sciences sociales, ces visions du monde s’affrontent.
Corporatisme catholique

En France, la doctrine corporatiste réunit autour d’elle plusieurs économistes, dont Gaëtan Pirou (lui aussi figurant dans le jury de thèse d’Henri Denis en 1938), François Perroux et le jeune Henri Denis. Celui-ci est issu d’une famille bretonne très catholique. Il est séduit par cette pensée qui, malgré sa diversité, entend défendre les valeurs de l’Occident et celles de la chrétienté.
Henri Denis obtient son doctorat et décroche l’agrégation de sciences économiques en 1942. Un an auparavant, en 1941, il publie La corporation dans la célèbre collection « Que sais-je ? » Ouvrage dans lequel il rend un hommage appuyé à François Perroux, et aussi à Gaëtan Pirou, dont il s’inspire pour comparer les différents courants corporatistes en Europe, du Portugal salazariste à l’Italie fasciste en passant par l’Allemagne nazie.
Dans cet ouvrage, il expose la véritable finalité du corporatisme : construire un nouvel ordre social et une nouvelle organisation de l’économie, centrés sur le corporatisme, sur la communauté de travail, sur l’artisanat, induisant la suspension du jeu capitaliste et des luttes de classes. Un an plus tard, Henri Denis va jusqu’à prétendre que le socialisme est la ruine de la civilisation.
Travaux financés par Vichy
Cette adhésion d’Henri Denis aux principes du corporatisme le conduit à rejoindre la Fondation française pour l’étude des problèmes humains créée en 1941, mieux connue sous l’appellation de Fondation Alexis-Carrel (du nom du Prix Nobel de médecine Alexis Carrel, qui prôna l’eugénisme). Son budget est alloué par le secrétariat d’État à la famille et à la santé du régime de Vichy.
Cette fondation est constituée de six départements, dont celui de « bio-sociologie », dirigé par François Perroux, qui fit appel à Henri Denis en 1942 pour traiter des théories économiques. Les conflits de personnes au sein même de la Fondation conduisent Perroux et Denis à s’éloigner d’Alexis Carrel. Mais c’est surtout la fin de la guerre, occasionnant un démantèlement progressif des institutions de Vichy, qui oblige les économistes à songer à leur reconversion.
Henri Denis, comme beaucoup d’autres, entreprend, dès le lendemain du conflit, une reconversion idéologique saisissante, inattendue même.
Du corporatisme au communisme
Afin d’effacer les années d’engagement dans le corporatisme et les fonctions accomplies dans les institutions du gouvernement de Vichy, l’heure est aux reconversions. Pour les universitaires, se soustraire à ce risque, c’est entreprendre une révolution idéologique, comme celle qui va caractériser Henri Denis.
On sait qu’après la guerre, le communisme s’impose, tant par le rôle joué par l’URSS dans l’issue de la guerre, que, dans le cas français, l’affirmation politique du Parti communiste français (PCF). Après un passage par l’Union des chrétiens progressistes (UCP), Henri Denis rejoint le PCF en 1953 – il quitte le PCF huit ans plus tard, c’est-à-dire au moment où il est nommé professeur à Paris.
Il dirige le quotidien Ouest Matin, une émanation des fédérations du PCF de Bretagne, « un grand quotidien régional d’information et de défense républicaine ». Il intègre le comité de rédaction de la revue marxiste Économie et politique, où il développe une critique des approches catholiques du marxisme.
En 1950, Henri Denis publie la Valeur. Dans cet ouvrage, il critique explicitement l’économie bourgeoise et cherche à démontrer la pertinence scientifique du marxisme en économie.
Enseignant communiste
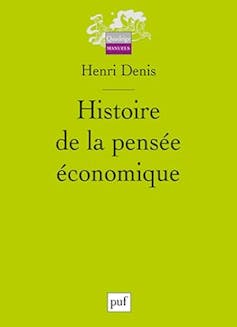
Professeur agrégé d’économie à l’Université de Rennes (Ille-et-Vilaine), Henri Denis est muté au début des années 1960 à ce qui est encore la Faculté de droit de Paris. Dans le cadre de son cours d’histoire de la pensée économique, Henri Denis publie en 1966 la première édition de son célèbre manuel Histoire de la pensée économique.
Comparativement aux manuels antérieurs (ceux de Charles Gide et Charles Rist, d’André Piettre ou d’Émile James, par exemple), la place de Marx et du marxisme dans le manuel de Denis est imposante : un bon tiers du manuel, soit plus de 200 pages. Elle témoigne de son engagement doctrinal et de sa connaissance de l’œuvre de Marx et des auteurs se réclamant de lui.
Nombreux sont les témoignages d’anciens étudiants devenus pour certains d’entre eux des professeurs d’économie qui indiquent que le manuel d’Henri Denis a contribué de manière décisive à l’implantation du marxisme dans les universités. La réception et la diffusion de l’Histoire de la pensée économique, d’Henri Denis, suscitent de nombreuses controverses. Elles opposent les professeurs plutôt conservateurs qui ont vu dans ce livre et dans le cours professé par Denis, une façon de corrompre la jeunesse française, tandis que d’autres y décèlent un renouveau de la pensée marxiste en France.
Discrédite le marxisme
Les années 1970 sont celles de la montée en puissance de la problématique des droits humains du totalitarisme, et du goulag en Union soviétique. L’étoile du marxisme commence à pâlir, et le discrédit jeté sur Marx et sur son œuvre s’affirme. Les signes annonciateurs du libéralisme se distinguent dans la science économique, et dans les mouvements politiques.
Henri Denis, qui, durant plus de vingt ans, met en avant la scientificité de l’œuvre de Marx, participe à son discrédit. Il publie, en 1980, l’Économie de Marx. Histoire d’un échec. Le terme « échec » apparaissant lourd de sens à une époque où l’idée de socialisme n’a plus cours, et est associée à la dictature.
Fidèle à une conception corporatiste de l’organisation de la société, Henri Denis revient plus de quarante ans après, sur cette doctrine dans l’un de ses derniers ouvrages, publiés en 1984, Logique hégélienne et systèmes économiques. Il indique qu’il s’agit d’une solution aux maux engendrés par le libéralisme (injustices et désordres) et à la tyrannie inhérente à la planification.
Girouette économique
En se penchant sur cette figure légendaire de la pensée économique en France, l’ambition était de montrer qu’Henri Denis, dans le champ même de la science économique, avait, comme d’autres, incorporé certaines règles du jeu social qui l’ont conduit à se situer en quelque sorte sur les sommets de la pensée économique. D’abord, en affirmant sa croyance en la doctrine du moment, le corporatisme, puis, en raison de la défaite de cette doctrine, en épousant la cause du marxisme, avant d’y renoncer.
Ce faisant, il s’agit de créer une anamnèse des origines d’un professeur, et de pratiquer une historicisation d’un parcours universitaire, en se libérant d’une forme d’illusion de l’autonomie de la sphère des idées. Les discours et les actions qui se constituent dans un champ, celui de l’économie en l’occurrence, sont sociologiquement déterminés par les conditions sociales de ceux qui en sont les dépositaires. Dit autrement, l’homme de connaissance ne peut être dissocié de l’homme individuel.![]()
Damien Bazin, Maître de Conférences HDR en Sciences Economiques, chercheur au GREDEG (Université Côte d’Azur, CNRS, INRAE) et Thierry Pouch, Chef du service études et prospectives APCA, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
THE CONVERSATION
Université Côte d’Azur, par son service Science et Société, a adhéré depuis janvier 2022 au média d’actualité en ligne « The conversation ». L’objectif est de mettre en valeur les travaux de nos équipes de recherche au service d’une information éclairée et fiable qui participe au débat citoyen.
The Conversation est un média en ligne et une association à but non lucratif. Son modèle de collaboration entre experts et journalistes est unique : partager le savoir, en faisant entendre la voix des chercheuses et chercheurs dans le débat citoyen, éclairer l'actualité par de l'expertise fiable, fondée sur des recherches.
theconversation.com
ABONNEZ-VOUS !
Pour suivre au quotidien les experts de The Conversation, abonnez-vous à la newsletter.
theconversation.com/fr/new




