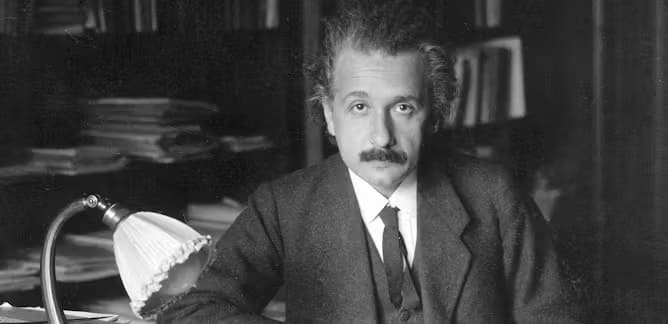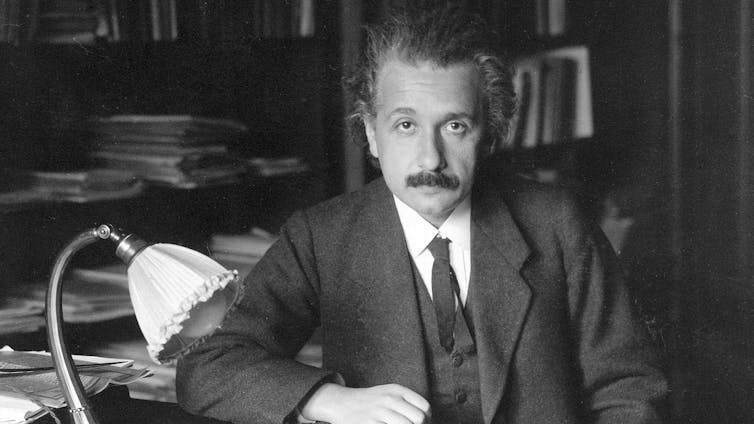
La relativité générale d’Einstein est souvent présentée comme une construction théorique guidée par des principes fondamentaux, plus que par l’observation. Le dernier de ces principes, connu sous le nom de « principe de Mach », est aujourd’hui largement tombé dans l’oubli. Pourtant, c’est lui qui a conduit Albert Einstein à introduire dans ses équations la constante cosmologique, aujourd’hui interprétée comme l’énergie sombre, à l’origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers.
Le mouvement est-il relatif ou absolu ? Si la question a longtemps animé les débats philosophiques depuis l’Antiquité, c’est surtout à partir du XVIe siècle, avec l’édification des lois de la gravitation, qu’elle a quitté la seule arène des philosophes pour entrer dans celle des astronomes et des physiciens.
Pour Isaac Newton, aucun mouvement ne peut être conçu sans la notion d’un espace rigide et absolu, servant de référence pour définir la trajectoire des objets. À l’opposé, pour Christian Huygens, Gottfried Wilhelm Leibniz, et plus tard Ernst Mach, ce sont les autres objets qui servent de repères. Dès lors, aucun mouvement ne devrait pouvoir être défini en l’absence totale de matière : ôtez toute référence matérielle, et il devient impossible de dire si un objet est en mouvement ou au repos.
Influencé par Mach, Einstein érigea ce point de vue en principe fondateur de sa théorie de la relativité générale. Il en mentionna l’idée pour la première fois en 1912, puis la qualifia tour à tour d’« hypothèse », de « postulat », avant de finalement l’appeler « principe de Mach » en 1918, en hommage au physicien et philosophe autrichien qui avait nourri sa réflexion.
À première vue, la relativité générale semble en accord avec ce principe, dans la mesure où l’espace n’y est plus la structure rigide et absolue de Newton, mais un objet dynamique influencé par la matière. En effet, dans la théorie d’Einstein, la gravitation n’est pas une force à proprement parler, mais la manifestation de la courbure de l’espace et du temps, induite par la matière : toute source d’énergie ou de masse déforme l’espace-temps, et c’est cette courbure qui gouverne le mouvement des corps.
Néanmoins, Einstein avait conscience que, pour satisfaire pleinement ce principe, il ne suffisait pas que la matière influence la géométrie de l’espace-temps : il fallait qu’elle la détermine entièrement. C’est ce qui le conduisit à modifier ses équations en y introduisant la constante cosmologique — que l’on interprète aujourd’hui comme l’énergie sombre, responsable de l’accélération de l’expansion de l’univers.
Pourquoi Einstein a introduit la constante cosmologique
Deux problèmes semblaient se poser à Einstein dans la version initiale de sa théorie de la relativité générale, sans cette constante.
Le premier est que ses équations admettent des solutions du vide : elles permettent, en théorie, l’existence d’un espace-temps même en l’absence complète de matière. Cela contredisait directement son « principe de Mach ». Il écrira d’ailleurs en 1918 :
« À mon avis, la théorie de la relativité générale n’est satisfaisante que si elle démontre que les qualités physiques de l’espace sont entièrement déterminées par la matière seule. Par conséquent, aucun espace-temps ne peut exister sans la matière qui le génère. » Albert Einstein, Actes de l’Académie royale des sciences de Prusse, 1918.
Le second problème concernait les conditions aux limites de l’espace-temps, c’est-à-dire, de la structure supposée de l’espace-temps à l’infini. Il semblait nécessaire de les introduire, mais elles étaient soit incompatibles avec son principe, soit conduisaient, pensait-il, à prédire un mouvement des astres lointains qui n’était pas observé. C’est peut-être d’une réinterprétation de cette difficulté qu’est née l’idée, aujourd’hui répandue, selon laquelle Einstein aurait introduit la constante cosmologique pour conformer sa théorie à une vision préconçue d’un univers statique et donc éternel.
Un univers fini mais sans bord
Comme il l’explique dans l’article où il introduit la constante cosmologique, celle-ci permet d’éviter le recours à des conditions aux limites problématiques, en autorisant un univers fini mais sans bord.
Pour se représenter ce qu’est un univers « fini mais sans bord », on peut penser à la surface d’une sphère. Elle ne possède pas de frontière — on peut y circuler sans jamais atteindre de bord — et pourtant, sa surface est finie (égale à quatre fois π fois le rayon au carré).
C’est ainsi qu’Einstein a inventé le tout premier modèle physique de l’univers dans son ensemble ! Il s’agit d’un univers sphérique, en équilibre, avec une répartition uniforme de matière. Si son modèle est celui d’un univers statique (c.-à-d., qui n’évolue pas avec le temps), il est clair que pour Einstein il ne s’agit que d’une première approximation qui permet de résoudre les équations.
Une impasse théorique
Mais nous le savons aujourd’hui : le modèle d’Einstein ne correspond pas à notre univers. Qui plus est, il est théoriquement insatisfaisant, car instable : tout écart, même minime, à l’approximation homogène qu’il utilise conduit à prédire sa destruction. Or, notre univers n’est certainement pas exactement homogène !
Ensuite, il est désormais établi — depuis que l’astronome néerlandais Willem de Sitter l’a démontré — que, même avec une constante cosmologique, la relativité générale admet des solutions dans lesquelles l’espace-temps peut, en théorie, exister sans aucune forme de matière.
De Mach à l’énergie sombre : l’ironique réhabilitation d’une constante
L’introduction de la constante cosmologique échoue donc à rendre la relativité générale compatible avec le principe de Mach — ce qui était, rappelons-le, l’intention initiale d’Einstein en introduisant la constante cosmologique dans ses équations. C’est vraisemblablement pour cette raison qu’Einstein qualifiera plus tard son introduction de « plus grande erreur de sa vie » (des propos relayés par George Gamow dans son autobiographie).
Ce principe oublié a ainsi poussé Einstein à penser l’univers dans son ensemble, donnant naissance à la toute première solution mathématique d’un univers en relativité générale — et donc à la cosmologie moderne. Par un enchaînement ironique de l’histoire scientifique, il l’a amené à introduire une constante pour une raison qui, en fin de compte, ne fonctionnera pas — mais dont l’adéquation aux observations sera confirmée des décennies plus tard, en 1998, par l’observation de supernovae lointaines. Cette découverte vaudra à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess le prix Nobel de physique en 2011, près d’un siècle après l’élaboration de la théorie d’Einstein.
Le rôle des hypothèses en sciences
La capacité de l’esprit humain à concevoir des principes abstraits qui peuvent dévoiler la structure du réel interroge. Comment une idée a priori, née sans données empiriques, peut-elle conduire à une loi objective du monde ?
Cela s’explique néanmoins simplement : les scientifiques formulent des hypothèses, des principes et des modèles — certains échouent et tombent dans l’oubli, d’autres se révèlent féconds. C’est ce que suggère la belle image du penseur-poète Novalis :
« Les hypothèses sont des filets : seuls ceux qui les jettent attrapent quelque chose ». Novalis, The Disciples at Sais and Other Fragments, Thoughts on Philosophy, Love and Religion, page 68, 1802.
C’est en jetant le sien qu’Einstein a donné naissance à la cosmologie moderne.
_Pour aller plus loin : la traduction française de l’article « Les Formulations d’Einstein du Principe de Mach », écrit par Carl Hoefer et traduit par l’auteur du présent article, est disponible ici.![]()
Olivier Minazzoli, Astrophysicien, chercheur au laboratoire ARTEMIS (Université Côte d’Azur, CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
THE CONVERSATION
Université Côte d’Azur, par son service Science et Société, a adhéré depuis janvier 2022 au média d’actualité en ligne « The conversation ». L’objectif est de mettre en valeur les travaux de nos équipes de recherche au service d’une information éclairée et fiable qui participe au débat citoyen.
The Conversation est un média en ligne et une association à but non lucratif. Son modèle de collaboration entre experts et journalistes est unique : partager le savoir, en faisant entendre la voix des chercheuses et chercheurs dans le débat citoyen, éclairer l'actualité par de l'expertise fiable, fondée sur des recherches.
theconversation.com
ABONNEZ-VOUS !
Pour suivre au quotidien les experts de The Conversation, abonnez-vous à la newsletter.
theconversation.com/fr/new